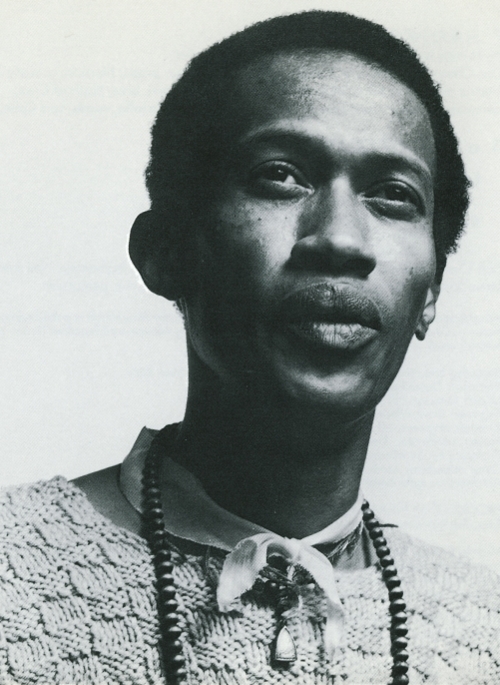Elan Mehler Trio « Being There, Here »
Elan Mehler (piano), Max Goldman (batterie), Tod Hedrick (contrebasse)
Challenge Records 2013
Chronique parue dans Citizen Jazz
De la mélodie : l’esquisse. Son ombre, projetée, jouée par les vents.
Ostinato, le piano tâtonne, progresse, cerne la mélodie, aidé par l’archet de la contrebasse et les balais de la batterie. La mélodie poursuivie, c’est celle de Duke Ellington, In A Sentimental Mood. En plus d’être signé par l’un des plus grands compositeurs de la musique africaine américaine, ce thème fut repris par bien des maîtres.
Les poursuivants, ce sont les musiciens du trio d’Elan Mehler, pianiste basé à Brooklyn. Aux deux tiers de ce morceau augural, la mélodie est attrapée. Son essence, en tout cas. Mehler, à l’instar de Bill Evans, tisse des fils entre Amérique et Europe, et mêle au jazz la langueur abstraite du Vieux Continent. « Being There, Here », « Etre là, ici » pourrait aussi se lire ainsi, et bien sûr comme la qualité première de toute musique, sa capacité (ici parfaitement appliquée) de faire s’évanouir l’ici, oublier le maintenant.
Les musiciens ici (et là) : Elan Mehler au piano, Tod Hedrick à la contrebasse et Max Goldman à la batterie, se connaissent bien et jouent depuis longtemps ensemble. Duke Ellington, le trio y reviendra à deux reprises : un thème en clôture (Solitude) et un autre en plein milieu du set (Reflections In D). La référence, ainsi, est dite. Et les trois plus beaux moments du disque proposés. D’autres reprises, bien sûr, émaillent ce disque, témoignage d’un concert donné en Suisse. Bemsha Swing de Thelonious Monk, Yes Indeed de Sy Oliver, le standard When I Fall In Love, Insensatez de Antonio Carlos Jobim. Le traitement est à chaque fois sensiblement le même: la brume enveloppe d’abord le thème qui lentement se découvre par petites touches progressives, comme si on en ôtait patiemment et amoureusement la patine pour en dévoiler l’intact éclat.